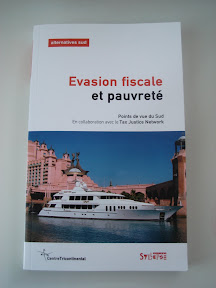Loin de moi l’idée de me lancer dans la psychanalyse (quoique j’aie récemment lu un fort mauvais roman « policier » mettant en scène le voyage de Freud aux États-Unis en 1909). Non, en fait, cette note parle plutôt des avantages et des inconvénients du travail « collaboratif » en traduction, et plus particulièrement, des mémoires de traduction « collectives ».
Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, une mémoire de traduction, c’est une sorte de base de données qui, grâce à une macro ou à un logiciel spécial, stocke automatiquement des « segments » d’un texte (généralement une phrase), en mettant en correspondance le texte d’origine et sa traduction. Quand, plus tard, un « segment » identique ou présentant une certaine ressemblance se présente (dans le même document ou dans un autre), le logiciel « extrait » le segment stocké et propose la traduction enregistrée. Il ne reste plus au traducteur qu’à la valider telle quelle ou à la modifier en fonction des différences dans le texte d’origine ou du contexte.
Inutile de vous dire que sur certains types de textes très répétitifs ou très ressemblants, cet outil peut offrir un réel gain de temps. Généralement doté d’une fonctionnalité de recherche « en contexte », il permet aussi de garantir une plus grande cohérence terminologique, puisque le traducteur peut vérifier comment il a traduit un certain terme 150 pages « plus haut » (ou deux ans avant) et réutiliser la même traduction. Sans compter que l’on peut bénéficier de toutes les traductions réalisées par un ou plusieurs traducteurs (les bureaux de traduction se chargeant généralement de compiler les travaux de leurs « pools ») sur un même sujet ou pour un même client. Bref.
Ces dernières années, certains éditeurs de logiciels et bureaux de traduction ont cherché à améliorer le concept en proposant des solutions « collaboratives » en réseau (au départ sur Intranet et désormais sur Internet). Ainsi, dix traducteurs peuvent travailler simultanément sur un même projet et alimenter en temps réel une mémoire de traduction commune à tous.
A priori, l’idée semble plutôt bonne :
1. Il y a plus dans dix têtes que dans une. On peut donc bénéficier des trouvailles des collègues et parfois récupérer des formules nettement plus adéquates que celles que l’on avait trouvées soi-même. En temps réel. Pas deux ans après.
2. Il est parfaitement inutile de retraduire ce qui a déjà été – bien – traduit si le contexte ne l’exige pas. Même si c’était par quelqu’un d’autre et seulement 2 minutes plus tôt. Chacun bénéficie donc du travail et des recherches de tout le monde.
3. Les traductions sont plus cohérentes, ce qui simplifie la vie des relecteurs chargés d’harmoniser entre elles les différentes parties d’un projet. À titre d’exemple, pensez au nombre de solutions qui existent pour traduire la simple phrase « For more information, see section blahblah » (« Vous trouverez de plus amples informations à la section blabla », « Pour plus d’informations, reportez-vous à la section blabla », « Pour plus d’infos, voir section blabla », « La section blabla contient de plus amples informations à ce sujet », « Pour obtenir plus d’informations, consultez la section blabla », « Lisez la section blabla pour en savoir plus à ce sujet », etc., etc. Admirez la créativité.)
Toutefois, ce mode collaboratif pose quand même quelques petits problèmes :
1. D’un point de vue purement technique, le système n’est pas très souple, puisqu’on est obligé, pour travailler, d’être en ligne. Le moindre pépin avec son FAI – ou avec l’hébergeur du serveur de MT (mémoire de traduction) – et on se retrouve coincé.
2. Les systèmes s’améliorent bien sûr avec le temps, mais il m’est déjà arrivé de perdre un temps précieux parce que le serveur avait du mal à gérer les requêtes simultanées des utilisateurs. Si on doit attendre ne serait-ce que 10 secondes entre deux segments, imaginez le temps perdu sur un document de 100 pages.
3. Certaines agences utilisent un format de mémoire « propriétaire », ce qui signifie que l’on doit se familiariser avec plusieurs logiciels ou interfaces et, dans certains cas, que l’on passe pas mal de temps à aller activer/désactiver des macros dans Word quand on passe d’un document à un autre.
4. Travailler en temps réel signifie perdre le bénéfice de la relecture. En tout cas, dans un premier temps. Quand les mémoires de traduction sont alimentées (ou mises à jour) a posteriori, c’est-à-dire sur la base d’une traduction finalisée (et donc relue, corrigée et validée), les coquilles, fautes d’orthographe et autres petites erreurs ont – en principe – été éliminées. La base de travail dont on dispose pour la suite est donc théoriquement fiable. Dans le cas de la collaboration en temps réel, on ne dispose que d’une mémoire dite « de travail », qui contient encore toutes ces petites imperfections – et grosses boulettes. Celles-ci peuvent donc plus facilement se répercuter sur plusieurs documents et le risque qu’elles passent inaperçues dans l’un ou l’autre augmente. Sans compter que tous les traducteurs ne font pas preuve du même sérieux dans leurs recherches.
5. Certaines agences exigent une correspondance exacte entre les traductions des différents traducteurs (puisqu’à la base, c’est le but de la mémoire collaborative), ce qui signifie que l’on n’est pas censé modifier les traductions existantes sauf erreur manifeste. Dans la pratique, on se trouve donc parfois dans l’obligation de valider une traduction certes correcte mais pas optimale, voire de faire un « puzzle au marteau » pour arriver à intégrer la phrase de quelqu’un d’autre dans son propre texte, chaque traducteur ayant son style propre et sa manière de dire les choses.
Bref, l’idée n’est pas mauvaise mais le système reste améliorable. En attendant, les traducteurs devront faire preuve de patience et de vigilance et les bureaux de traduction peut-être d’un chouïa de souplesse en plus…